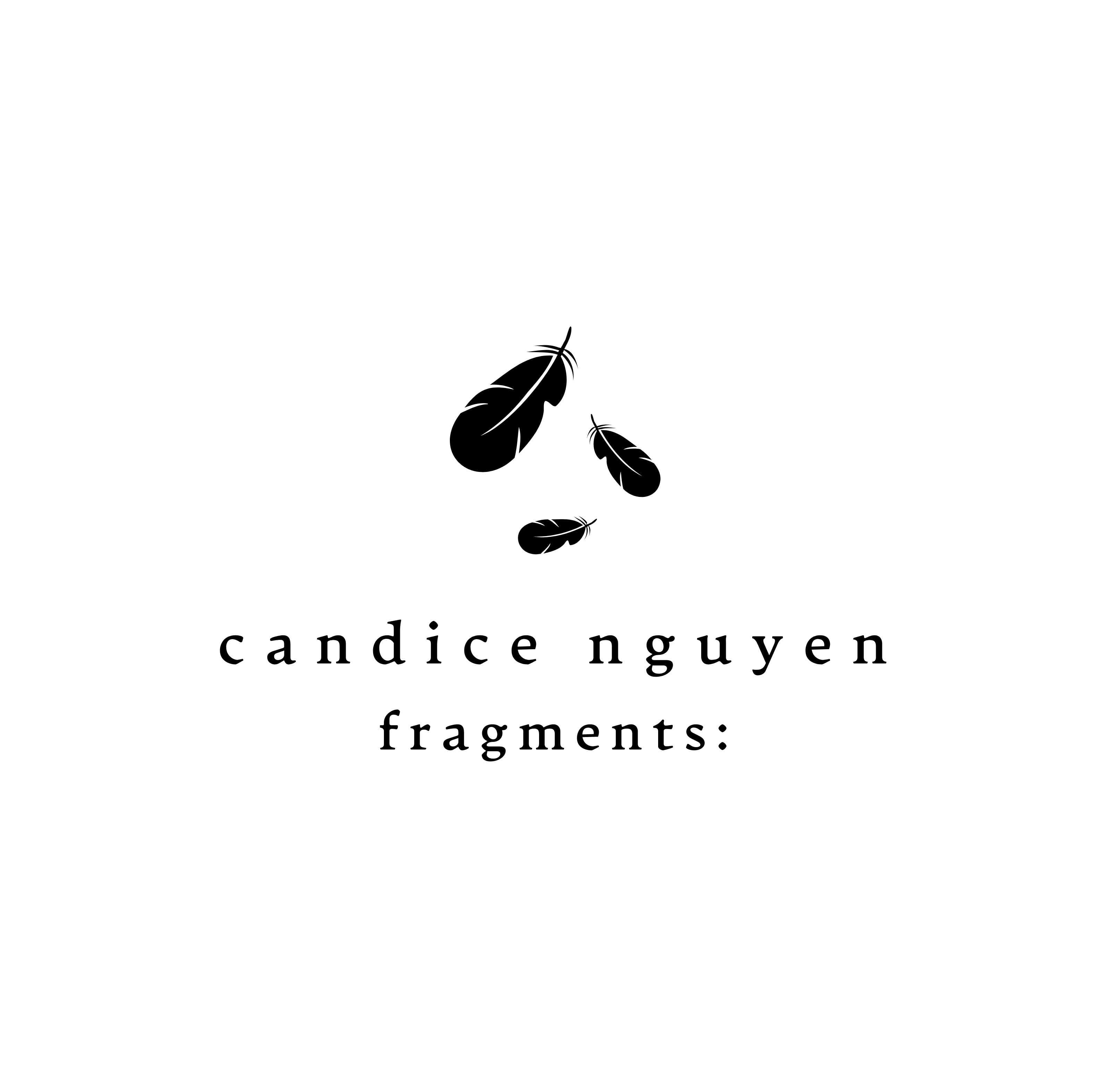Ces vies que l’on exhume un soir par la grâce de mots échappés, des photographies que l’on retrouve comme un vieux poème oublié.
C’est une chaleur assourdissante un après-midi d’été à Loreto. C’est la Haute-Corse, un petit village raccroché aux montagnes au beau milieu des forêts. C’est une place, A Piana, sur laquelle se succèdent une à une des générations à l’ombre de platanes centenaires puis au gré des saisons et des heures de la journée. Ce sont des gravillons, de la terre, des jeux de boules, des bancs – leurs conversations étouffées. Ce sont des restaurants à viande, côtes de bœuf frites salade – et leurs apéritifs interminables dont l’addition se jaugera au temps qui s’écoule attablés. Ce sont des familles, des amis – et leurs conversations jusque tard dans la nuit animées. C’est Loreto, aux toits de lauze de schiste, ces teintes grises argentées, bleutées et verdâtres que les eaux et les monts auront à travers les temps sédimentée et que la mousse aura peu à peu grignotée. C’est Loreto, cette vue sur la Méditerranée, sur les plaines que l’on cultive à perte de vue, et par-delà les eaux salées, c’est ce rapprochement de l’archipel toscan qui s’offre à nos yeux tout entier. C’est Loreto, c’est l’ombre des feuillages comme désir, les siestes comme nécessité et peut-être si l’on sortait la voiture aujourd’hui, les baignades comme le rafraîchissement de nos corps atrophiés.
C’est cette langue que je ne connais pas mais dont je reconnais les visages. C’est ce bar de nuit où les jeunes se retrouvent pour s’enfiler des mètres et des mètres de shots d’alcool fort dans une musique trop forte accablée par des néons bleus et violets. C’est ces routes en lacet qui donnent le mal au ventre, la nuit totale en dehors comme en dedans aux plus inconscients, aux plus malchanceux, c’est cette forêt partout, ces ravins tout autour. C’est un lieu de triste pèlerinage pour ceux qui viennent se recueillir sur la pierre de leurs enfants, c’est cette vie qui se donne et se retire sans préavis, ces questionnements sans fin sur ce qui est juste, ce qui est foi, ce qui est donné à comprendre et ce qui contre tout désir ne le sera pas. C’est cette église dont on va demander la clef, énorme de métal et de rouille, à la vieille endormie sur son banc à côté. C’est cette odeur d’humidité, de poussière et de renfermé que vient éclairer l’épaisse percée de rayons de soleil, ce sont ces effigies, ces tableaux, ces cierges, ces sculptures partout dépareillées où les saintes côtoient Jeanne côtoie Marie. Ce sont ces amis chers au cœur, ces rencontres, ces amours, dans la chaleur silencieuse d’un soleil trop fort. Ce sont ces quelques mots lâchés parfois, cette pudeur constante, ces gestes, ces sourires, ces regards pour exprimer tout ce qu’il reste de l’essentiel.
Ne se souvenir alors que des odeurs, des sensations et des variations de lumière. Toujours. Encore. Et je veux ajouter, apprendre peu à peu à se fier aux sentiments plus qu’au souvenir. Ces photographies comme béquilles de ma mémoire qui lui font renaître des vies, et qui la font renaître en même temps. Ces quelques mots qui tentent de redessiner les autours comme pour compléter le hors-champ de béquilles elles aussi amputées. Que vouloir continuer à photographier alors sinon ces instants, ces êtres, ces vies, ceux qui sont chers, ceux de passage, ceux qu’on oublie, et ceux qui un soir comme ce soir, resurgissent du passé.
Voir aussi :