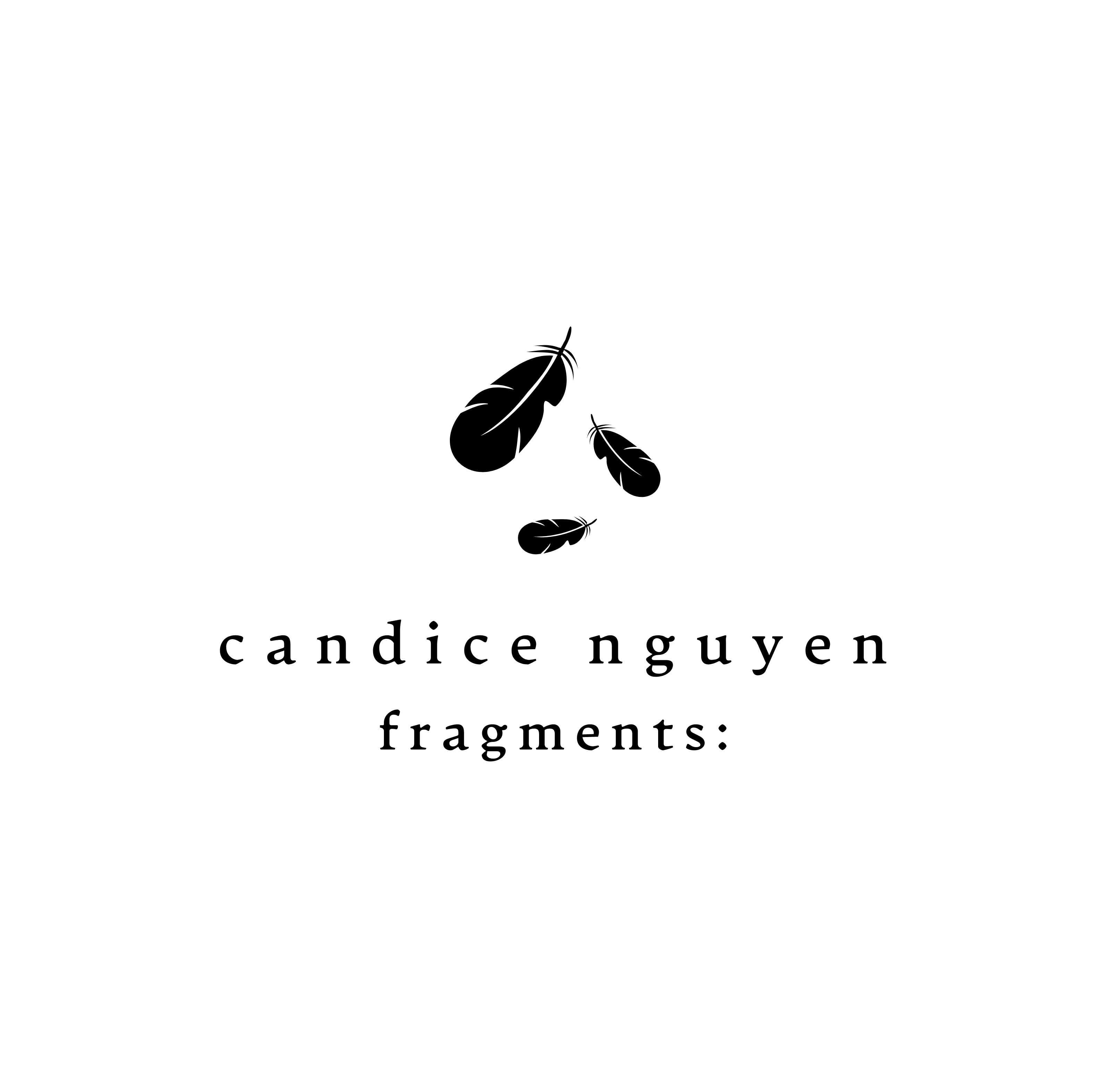_making-of de cette chronique publiée dans L’Autre Quotidien
Nous étions dans les hauteurs de Sapa, Nord Vietnam, près de la frontière chinoise. Après un mini trek quelque peu compliqué pour moi dans les montagnes (de l’asthme fort encore une fois et surtout, beaucoup trop de charges émotionnelles liées à ce voyage particulier à la fois familial et dans le temps distordu), nous étions enfin arrivées chez l’habitant chez qui nous devions dormir, ma sœur, ma mère et moi.
Le soir, assises en demi-cercle autour du feu qui trônait là dans la cuisine, dans cet intérieur fait de roche polie et de bois, un Autrichien m’avait fait une séance de magnétisme pour calmer cet asthme et ce poids (lourd très lourd, de tristesse et d’émotions qui me submergeait alors), il me parlait en allemand, je traduisais en français, ma mère traduisait à son tour en vietnamien à la guide qui nous accompagnait alors et qui traduisait à notre hôte dans le dialecte Hmong – puisque nous étions chez les Hmong noirs, une des 54 ethnies qui peuplent le Vietnam (chacune ayant leurs langues et coutumes propres).
Tout ça pour expliquer un peu le flou surréaliste dans lequel j’étais plongée en ces heures-là, entre la fièvre et ces nappes de traductions superposées où les langues et les vécus de chacun se mélangent, tentant de communiquer, laissant évidemment passer des choses, des malentendus, des incompréhensions, des curiosités.
La vieille femme Hmong nous raconta alors un peu plus tard qu’aux frontières, les jeunes filles disparaissent souvent, embarquées par des inconnus, des rapts aux frontières de petites filles à peine écloses à la vie. C’était le cas de sa dernière enfant, un jour partie en balade et jamais revenue.
Cette vieille femme dont je ne comprenais pas la langue mais dont les larmes sont universelles, j’y ai repensé des années après, alors que j’étais de retour à Marseille, bien au chaud, protégée, et puis vint cette chronique qui mélange alors nos voix, de mères, de filles, de femmes, d’enfants.
Mon texte est un peu obscur, par trop littéraire, mais je crois qu’il s’agit là plutôt d’une sorte de chant, de prière, floue et à brûler comme de l’encens.
cœur vibre encore sous mes pores de la louve abattue cette femme qui pleure la petite aux frontières perdue
son visage de mère ne pas non ne pas le photographier et depuis l’effacer contours de son visage flottent s’emparent des traits de toutes et pour elles parle encore louve résignée
les hommes des étrangers ou peut-être nos frères dans ce rapt embarqués vers où disparaissent une à une les fleurs des montagnes aube de nos chairs la dernière aux frontières envolée
je l’entends encore résonner nuée vibre par delà les mers et les temps jusqu’ici cette chaise elle parle encore louve résignée
la petite dernière perdue entre les montagnes ou quelque part plus loin à la ville descendue entre les mains de qui entre les mains de qui es-tu
pleure la petite et l’espoir perdu sous mes pores vibre encore le rapt des petites fleurs perdues
un matin elle n’est pas revenue un matin comme celui-là calme comme celui où tu as trouvé mon chemin entre les montagnes et les eaux tout là-haut
des hommes des étrangers à la frontière ils se servent ils se servent et cueillent les fleurs à peine écloses souvent encore frêles bourgeons sur leur cœur tous resserrés
je rêve alors qu’elle chante qu’elle me dit tout cela de plus pour elles pour toutes pour les mères les louves les fleurs face mer et face toits qui pleurent ici jusque là
un jour tu t’échappes la soupe au chaud une natte et notre maison nous oublierons et reprendrons le chemin des rivières coule coule l’orée des forêts et le calme des bufflonnes reviens petite reviens à la frontière en haut des montagnes notre maison et tes sœurs envolées
cours petite cours sur ton chemin mords frappe abats et saigne ces hommes ces étrangers et nos frères embarqués cours petite cours jusqu’à ce que le souffle te lâche ta mère à tes côtés dans les côtes mords frappe et bats les trottoirs les passants et la ville que saignent les campagnes sous tes pieds
cours petite cours retrouve le fleuve et longe les eaux traverse les forêts les frontières tes sœurs avec toi envolées et cette grotte une nuit pour reposer tes lames et tes cuisses couleur du thé cours petite cours reviens au matin dans les montagnes près de nous le chaud et l’orée des forêts
mais quels mots pour le dire barrage de la langue et surtout quoi dans cette vie