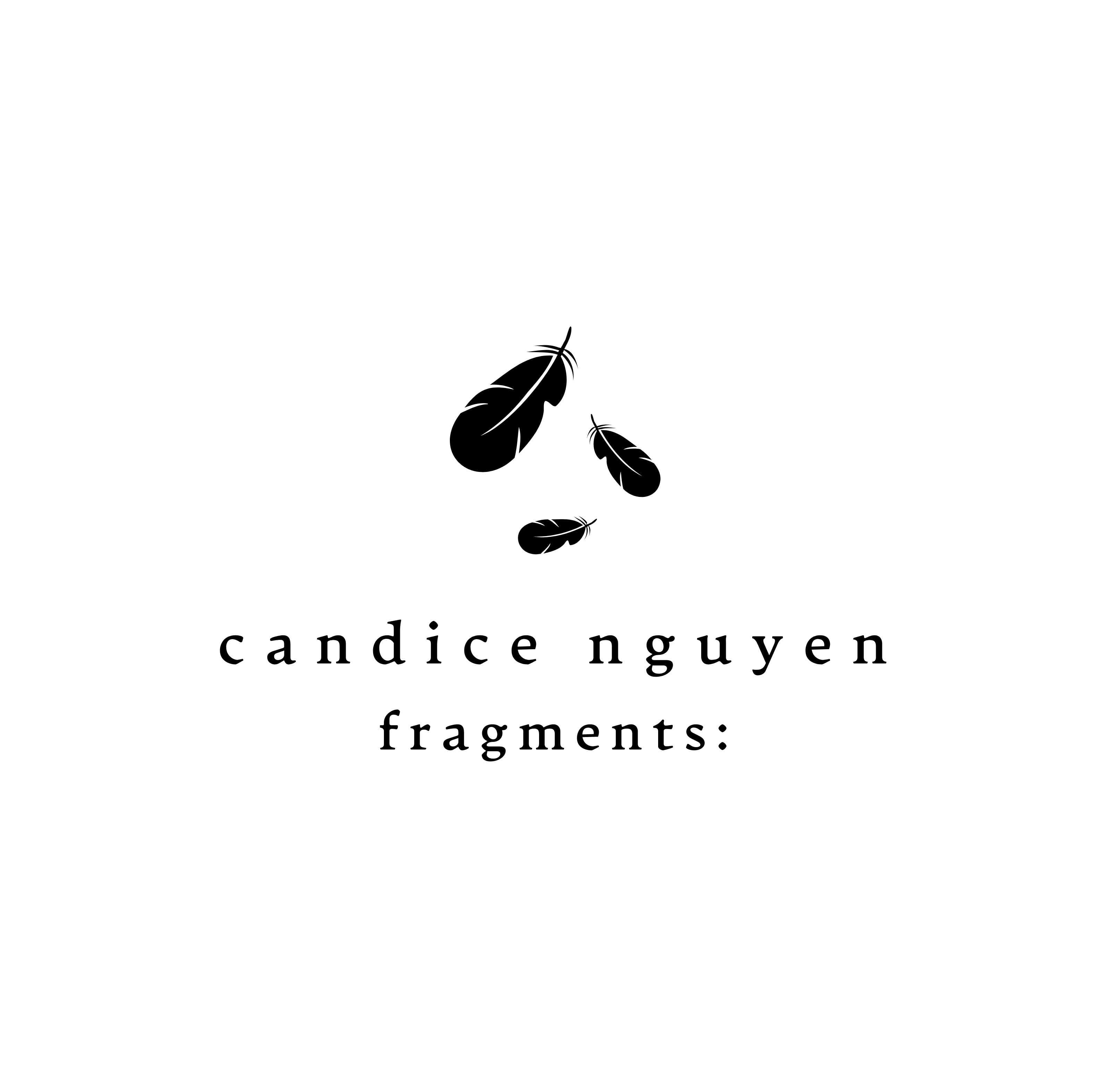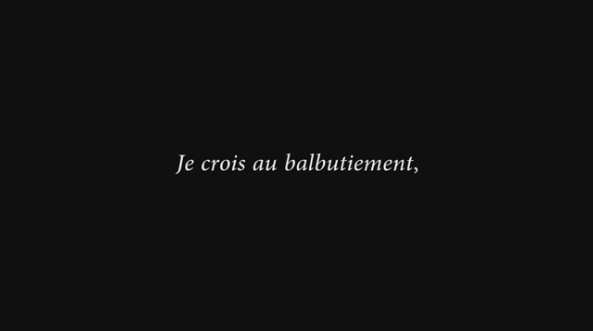c’est écrit
by Eric Schulthess
#VasesCommunicants
Les côtes d’Europe semblent approcher maintenant. Bientôt, la liberté. C’est écrit.
Cinq nuits et cinq jours que nous voguons sur ce bateau aussi brûlant qu’un four à pain au village.
Peu de femmes. La plupart des passagers sont de jeunes hommes. Certains ressemblent à mes cousins encore adolescents.
Ils ont choisi pour moi.
Pas eu mon mot à dire. Comme tant d’autres femmes avant moi.
L’oncle a décidé.
Mes frères aînés se sont rangés derrière sans une parole.
Pas eu le temps de m’indigner.
M’ont montré l’homme assis là-bas. Première fois que je le voyais.
Étalé sur un fauteuil de ministre en bois brillant. Lunettes épaisses et barbe grise.
À genoux j’ai dû cheminer vers lui. Bien gardé la tête droite en le fixant de toute ma rage.
M’a serré la main en regardant ailleurs et puis la musique a fait chavirer la galerie dans une liesse hachée de cris suraigus et d’applaudissements mécaniques. Lui n’a pas mis longtemps avant de somnoler. L’oncle a pris son enveloppe et ne s’est pas attardé. Il a rejoint ses quatre épouses je suppose.
Moi, je suis la deuxième de cet homme gras de partout. Visage et ventre gras. Peau grasse luisante. Doigts épais cerclés de larges et hautes bagues en argent.
– Mokh c’est ton mari pour la vie, m’ont lancé mes frères. C’est écrit.
J’ai fait mine de ne pas entendre.
– Ne te plains pas, Oumy, m’a glissé à l’oreille ma cousine, mariée à dix-neuf ans à un vieux de soixante-cinq. Le tien a de l’argent. Il t’offrira des bijoux en échange de ton travail d’épouse. Le mien n’a que quelques billets fripés à me donner pour faire tourner la maison.
Je n’ai rien trouvé à lui répondre.
Celui que j’aime, ils me l’ont refusé.
Nous nous connaissons depuis l’enfance avec Babacar. Le seul qui me faisait rire. Le seul qui était gentil. À l’école, il comprenait le premier. Toujours. M’expliquait et m’aidait quand je me trouvais un peu perdue.
Un jour, il n’est plus venu. Un beau matin plus de Babacar. Parti travailler en mer avec son père. Des mois de pêche au large de la Casamance. Nous retrouvions à son retour. Descendais au port guetter son arrivée. Je me souviens que son sourire allumait au creux de mon ventre des ondes de désir. Me souviens aussi qu’il gardait longtemps ma main entre ses doigts rugueux et me demandait de lui raconter la vie en son absence.
Et puis il repartait. Le cours des jours et des nuits reprenait son rythme. D’une épuisante lenteur. L’appel à la prière lancé à l’aube. Il me sortait du sommeil. L’école. Les kilomètres à pied pour y aller. Le ventre vide parfois. En rentrant, les petits frères et les petites sœurs à garder. La promiscuité dans les chambres. La maman à consoler lorsque les mots des autres épouses la blessaient. Supporter aussi les coupures d’électricité à répétition. Endurer les soirées à espérer dans l’obscurité. Et surtout l’absence de Babacar. Le manque de son sourire et de ses doigts brûlants de travailleur de la mer.
Ce sourire et cette chaleur, ils ont donc choisi de m’en priver. Sans m’en parler. Pas eu mon mot à dire. Même pas eu le temps de leur expliquer. Pas le droit à la parole les femmes ici.
Ce droit, j’ai décidé de le prendre en silence. Partir, je me suis dit. Ailleurs. C’est le seul mot qui m’est venu en tête.
Pas eu le temps de prévenir Babacar. Ai prétexté une course à l’alimentation voisine et suis monté dans le premier taxi-brousse pour Dakar. Personne ne m’a rien demandé pendant le trajet. J’ai pu dormir un peu je crois malgré les cahots et les cris du chauffeur excédé par moments de ne pouvoir doubler les camions chargés de ciment et de parpaings.
Arrivée à Dakar, me suis rendue sur le port. En face de l’embarcadère des bateaux qui mènent à Gorée, l’île aux esclaves. Babacar m’y attendait. Je l’ai reconnu dans la foule. Son sourire a traversé les rangées jusqu’à mon cœur. Babacar est un magicien. Avons donné l’argent à un homme en costume blanc. Caché derrière ses lunettes miroir. Assis à une petite table d’écolier juste à côté de la passerelle. Un sac de voyage en cuir fauve posé dessus. Lui ai remis toutes mes économies. Tous les billets laissés par les Toubabs lorsque je portais leurs courses du marché aux poissons ou au supermarché. Des années de travail lorsque nous n’avions pas école. Réservé aux garçons mais savais me faire accepter. Toujours été travailleuse. Me suis toujours donné la peine de gagner de quoi m’offrir une petite tenue pour les jours de fête. Les mariages. Les communions. De quoi mettre de côté aussi. Pour plus tard. En secret.
Sur le bateau, les hommes ont commencé à chanter pour se donner du courage. Babacar m’a prévenu que ce serait très long. Ai gardé ma main dans ses doigts chauds. En pleine mer, sans le moindre bout de terre à l’horizon, certains se sont mis à prier sans interruption. Dans leurs yeux, j’ai lu l’angoisse de finir là, au milieu de l’océan, soulevés par les vagues et lancés au fond parmi les gros poissons. Moi je n’ai pas eu peur. Babacar m’a rassurée quand je me suis demandé pourquoi personne ne venait s’occuper de nous. Nous donner à boire et à manger. M’a expliqué qu’il nous faudrait ne compter que sur nous-mêmes. Comme au pays. M’a raconté que là-bas, ce serait dur mais qu’au moins nous serions libres. Alors, j’ai fermé les yeux et n’ai plus lâché ses doigts.
Il me semble donc que les côtes d’Espagne approchent. C’est là que nous devons débarquer nous a expliqué l’homme qui encaissait à Dakar. L’Espagne. Jamais entendu parler. La France, oui, bien sûr. Mais il paraît que c’est plus loin. Cette France où Babacar et moi nous marierons bientôt Inch’ Allah.
Cette France, nous ne la verrons pas de si tôt car trois bateaux espagnols se rapprochent de nous à présent. À leur bord, des policiers avec hauts-parleurs. Ils hurlent et nous font signe de rebrousser chemin. Ils agitent leurs bras en nous montrant l’horizon.
Des dizaines de jeunes se mettent à crier et à protester avant de sauter à l’eau. Quelques uns ne remontent pas à la surface, victimes sans doute d’un chaud-froid. La plupart nagent à l’arrache vers la rive. Je les aperçois qui s’épuisent au fil des minutes.
Babacar et moi, nous restons calmes sur ce bateau dont le moteur tressaute à présent. Panne de gasoil. Le voilà qui dérive calmement vers cette Europe qui ne veut pas de nous mais où nous débarquerons bientôt, j’en suis sûre. Libres.
C’est écrit. Je ne sais où, mais je sais que c’est écrit.
Eric Schulthess
www.sonsdechaquejour.com
www.carnetdemarseille.com
* * *
Je remercie Eric Schulthess pour cette invitation et cet échange fort bien trouvé sur le thème de l’ailleurs, plutôt cher à mes yeux. Je vous invite à découvrir, si ce n’est déjà fait, son recueil Marseille Rouge Sangs aux Éditions Parole ainsi que son site sonore www.sonsdechaquejour.com, petit brin de poésie sonore dont il faudrait quotidiennement s’injecter une dose, comme une immersion dans le vrai monde — ode à ceux qui comme moi, passent à minima 12h par jour derrière un écran d’ordi).
Vous pouvez découvrir aussi ma dérive sur son site ici ; et comme à mon habitude, j’ai un peu dévié du cadre proposé, à croire que mon cerveau aime particulièrement montrer ses aptitudes à contredire les cadres, les contraintes, toussa (ce qui est tout à fait agaçant mais ne nécessite pour autant pas encore de psychanalyse).